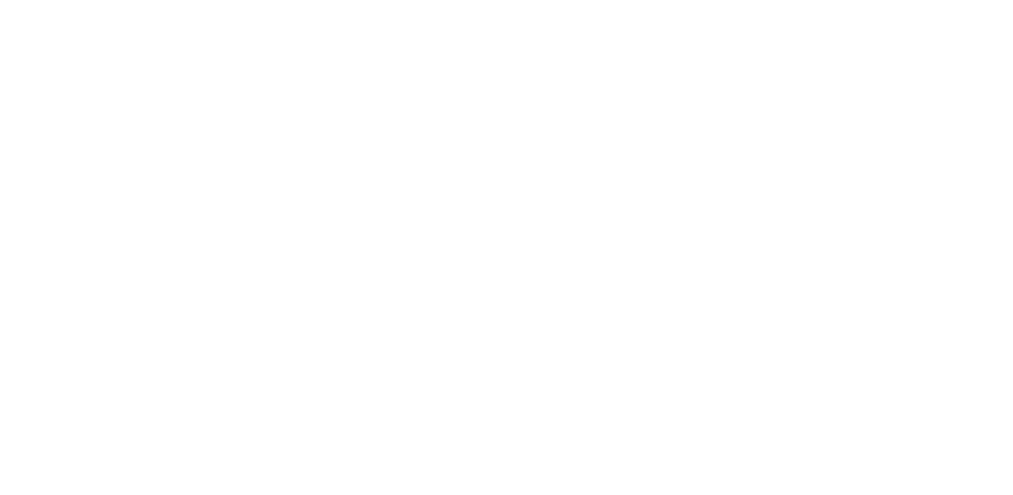Dans beaucoup d’ateliers à Cotonou, les tabous autour de la sexualité sont encore tenaces. Les informations circulent mal, et les apprenties se retrouvent souvent livrées à elles-mêmes. Pourtant, la santé sexuelle et reproductive des apprenties est une question urgente. Les grossesses précoces, la stigmatisation et les avortements clandestins rappellent chaque jour les conséquences du silence. Ce constat a motivé l’ONG Filles en Actions à prendre les taureaux par les cornes. Le 2 septembre 2025, l’organisation a réuni vingt patronnes d’ateliers à Yénawa pour une journée d’échanges. L’objectif est mieux faire connaître la loi SR-2021, lever les tabous sur l’IVG et donner aux patronnes les outils pour accompagner leurs apprenties.
Les patronnes d’ateliers sans langue de bois

Les échanges ont été francs. « L’avortement clandestin conduit à la mort », a déclaré l’une des participantes dès l’ouverture de l’atelier. Pour une autre, « la femme qui a déjà avorté ne mérite pas d’être rejetée ». Entre santé et tradition, certaines ont choisi leur priorité. « Entre m’accrocher à la tradition et préserver ma santé, je préfère ma santé. » selon une patronne de salon de coiffure.
Neuf heures de discussions dans une ambiance détendue ont permis à vingt femmes de mieux comprendre les enjeux de la santé sexuelle et reproductive. Au centre des échanges : la nécessité de diffuser une information fiable et de réduire la stigmatisation autour de l’IVG. Tout ceci s’est tenu dans un espace sûr et sans jugement. Les patronnes ont posé des questions, partagé leurs expériences et confronté leurs réalités.
L’une d’elles raconte : « Trois de mes neuf apprenties étaient enceintes. L’une est partie. Les deux autres, j’ai essayé de les soutenir, mais c’était compliqué. Elles étaient en détresse et finalement, elles ont échoué à l’examen. Sans cette grossesse, elles auraient pu réussir. » Pour elle, la solution passe par un meilleur dialogue : « Je rassemble souvent mes apprenties et je prends leur avis. Cela change beaucoup de choses. »
Deux heures dans les toilettes ? Pour quoi ?
Dans les ateliers, les informations liées à la santé sexuelle et reproductive circulent essentiellement entre les apprenties. Le mimétisme, les pressions sociales et les difficultés financières renforcent certains comportements à risque. « J’ai le témoignage d’une de mes apprenties. Elle a fait deux heures dans les toilettes, c’est ce que ses collègues m’ont fait croire. Des heures après, je suis entrée et je n’ai trouvé personne. ». Ce sont les propos d’une patronne de salon de coiffure. Elle poursuit : « Un matin, je suis arrivée plus tôt à l’atelier et j’ai découvert qu’elle avait découché. Ses amies l’ont couverte. Elle avait passé la nuit chez un homme sans prévenir. »
Par ailleurs, à en croire les cheffes d’ateliers, ces comportements trouvent souvent leur origine au sein des familles elles-mêmes. « Parfois, ce sont les parents qui sont complices de ces agissements », confie l’une d’elles. Les apprenties en générale manquent de soutien parental sachant qu’elles passent la majorité de leur temps à l’atelier. « Pendant que nous essayons de leur donner des conseils, les parents se liguent contre nous. Ils ne parlent pas de sexualité avec leurs enfants et, quand nous essayons de le faire, on nous taxe de vouloir apprendre des bêtises », regrette une patronne.
Toutes s’accordent sur l’importance d’agir. Toutefois elles se heurtent au manque d’informations. Sans ressources suffisantes et face à la pression sociale, certaines finissent par renvoyer les apprenties pour se protéger. Ce choix est souvent complexe mais imposé par les circonstances. Cela prouve à suffisance le bien fondé de l’atelier.

Apprendre sur la santé sexuelle et reproductive des apprenties
Suite aux causeries, il fallait installer l’espace de prise d’information. Cela a été ponctué d’abord par l’écoute d’un podcast en langue locale sur historique sur la loi SR 2021. Ensuite, l’intervention de la cheffe du guichet unique de protection sociale, madame. Face aux patronnes d’ateliers, elle a expliqué les notions de planification familiale et violences basées sur le genre.
Une large partie des échanges a été consacrée à la loi SR-2021. Beaucoup de patronnes ignoraient encore ses dispositions, notamment l’élargissement des conditions d’accès à l’IVG sécurisée pour les femmes en situation de détresse. La cheffe GUPS a expliqué que cette méconnaissance crée un double problème. D’une part, les jeunes filles ne connaissent pas leurs droits. D’autre part, les encadreuses ne savent pas comment les orienter vers des structures adaptées.
Selon la cheffe du GPS, l’absence d’information fiable reste l’une des causes majeures des grossesses précoces, des avortements non sécurisés et des complications médicales chez les jeunes filles. Lorsque les tabous persistent, les apprenties se tournent souvent vers leurs pairs, au risque de recevoir des informations fausses ou incomplètes. Dans un tel contexte plus les encadreuses sont formées, plus elles peuvent accompagner efficacement les jeunes.
Un appui institutionnel pour sauver des vies

La présence et l’implication des autorités locales ont donné un poids particulier à l’activité. Ce soutien institutionnel renforce la portée des messages, tout en légitimant les efforts des ONG et des actrices communautaires engagées sur le terrain. Le Chef d’arrondissement du 2e a rappelé qu’ :
« En tant qu’autorités locales, nous devons activement lutter contre la désinformation et les avortements clandestins. Le bien-être des filles de notre arrondissement, et du Bénin en général, est une question de justice et de développement. Chaque vie sauvée est une victoire pour notre société et un pas vers un avenir plus juste et plus équitable. »
Le CA a insisté sur la nécessité de renforcer les synergies entre les structures sanitaires, les communautés et la société civile afin de garantir un meilleur accès à l’information, aux services de santé reproductive et à l’accompagnement.

Pour la présidente de l’ONG Filles en Actions « Chacun a un rôle essentiel à jouer dans la société et rien de grand ne se construit dans l’isolement. Protéger la santé des jeunes filles est une responsabilité collective. »
Selon Brian SOSSOU, leurs espaces vont bien au-delà de la formation professionnelle. Dans ces lieux, les apprenties trouvent une oreille attentive, un cadre rassurant et parfois un véritable refuge.
« Vous êtes des figures d’influence, des relais d’information et souvent des confidentes pour les jeunes filles que vous accueillez. Vos ateliers ne sont pas seulement des lieux d’apprentissage. Ce sont des espaces de confiance où des centaines de jeunes filles trouvent écoute, conseils et parfois protection. »
Du collier du cycle menstruel au plan d’action
Pendant la formation, les patronnes ont appris à fabriquer le collier du cycle menstruel pas à pas. Une perle après l’autre, elles ont découvert une méthode simple, pratique et accessible pour mieux comprendre et expliquer le fonctionnement du cycle. Certaines découvraient l’outil pour la première fois, tandis que les plus expérimentées ont guidé les novices pour faciliter son appropriation.
Grâce à cet outil, les patronnes pourront désormais aider leurs apprenties à mieux connaître leur corps, parler de contraception, aborder la planification familiale et transmettre des informations fiables sur la santé reproductive.
La journée s’est ensuite achevée sur une dynamique collaborative. Les participantes ont co-construit un plan d’action concret pour restituer les acquis auprès de leurs apprenties, favoriser le dialogue intergénérationnel et renforcer leur rôle de relais communautaires.
Hontongnon Yanick ZOUNTCHEGBE